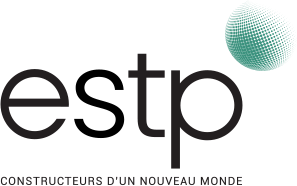Résilience des territoires : La soutenabilité des régions face aux défis écologiques
- POSITION PAPER -
Face à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre comme d’intégrer la raréfaction des ressources, il est devenu essentiel d’évaluer les risques écologiques à l’échelle territoriale. Le critère de « soutenabilité écologique » doit être étudié avec rigueur et guider l’action des territoires. Cette nouvelle approche exigeant une perspective globale, systémique et interdisciplinaire est au coeur des convictions et du travail de deux chaires de recherche et d’enseignement1 de l’ESTP.
Comme ses prédécesseurs, le sixième rapport d’évaluation du GIEC met très clairement en garde contre les effets du changement climatique. La multiplication des épisodes de sécheresse, canicules, tempêtes et autres événements extrêmes en sont des illustrations tangibles. Alors que les émissions de gaz à effet de serre (GES) continuent d’augmenter, il est plus qu’urgent d’engager des mesures drastiques pour décarboner notre système de production et de consommation. Une ambition qui n’est pas sans heurts dans une économie dont les fondements mêmes reposent sur les énergies fossiles.
Les territoires se trouvent en première ligne de ce changement de paradigme. Afin de continuer à fonctionner et répondre aux besoins essentiels de leur population, il leur faut évoluer voire se transformer. Pour les territoires, l’idée n’est pas de revenir à une situation antérieure à la révolution industrielle, mais bien d’ancrer pleinement leur stratégie dans le monde actuel. C’est là qu’intervient la notion de résilience, c’est-à-dire, la capacité des territoires à s’adapter à des perturbations majeures en se réorganisant ou en modifiant leur structure tout en préservant leurs fonctions essentielles, leur cohésion, leur identité et leur capacité de gouvernance.
BIENVENUE EN 2051
En l’absence de données et d’observations en matière de résilience des territoires, imaginons un futur pas si lointain : octobre 2051. La présidente de l’une des 300 régions naturelles de France organise depuis 2023, et pour la 28e année consécutive, leur assemblée pour la « résilience territoriale de la région naturelle ». On parle de « région naturelle » ou « pays traditionnel de
France » pour définir un territoire d’étendue limitée présentant des caractéristiques physiques homogènes en raison de sa situation, son climat ou son paysage naturel, ou du fait de son économie, son histoire et ses caractères humains ou ethnologiques.
Cette année est particulière : les objectifs fixés en 2024 ont été réalisés malgré les chocs et les stress chroniques à l’échelle de la planète et à celle du territoire. Non seulement, la collectivité a pu réduire de 85 % ses émissions de GES par rapport à 1990 mais elle a aussi réussi l’exploit d’équilibrer le solde résiduel de ces émissions sur la totalité des chaînes de valeurs dans lesquelles le territoire est impliqué avec le secteur des UTCATF2 qui regroupe les émissions et les absorptions des puits de carbone naturels du territoire. La consommation énergétique est revenue à celle de la fin des années 1960, ce qui correspond à la trajectoire des futurs énergétiques que RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, avait publié en février 2022. Ce territoire rural a vu sa population tripler sur la période et malgré tout, les indicateurs en termes de logement, d’alimentation, de santé, d’éducation, de sécurité et de justice n’ont jamais été aussi bons.
Souhaitable et, plus encore, possible, un tel futur n’est pourtant pas l’horizon qui se dessine pour nombre de territoires. C’est en tout cas le constat qui est largement partagé par la communauté scientifique, et qui appelle à un changement de paradigme de développement, de forme de gouvernance et de méthodologies pour guider une action collective transformatrice soutenable d’un point de vue écologique.
DÉVELOPPEMENT DURABLE : REDÉFINIR LE CONCEPT POUR REPENSER L’ACTION COLLECTIVE
Afin d’aiguiller l’action collective en matière de résilience territoriale, il est nécessaire de revenir à la définition du terme de « développement durable » – et de ce que l’on peut considérer comme une erreur de traduction. Si, contrairement à ce qui est régulièrement affirmé, le rapport « Notre avenir à tous », dit rapport Brundtland3 n’a pas, pour la première fois, évoqué la notion de « développement durable », le concept s’est imposé depuis comme une vision politique du développement, principalement dans les pays occidentaux.
En effet, une publication antérieure (IUCN, 19804) fait état du concept de « sustainable developement » avec, comme condition préalable à son existence, la conservation des ressources vivantes : « la conservation est une approche positive qui englobe la préservation, la maintenance, l’utilisation soutenable, la restauration et l’amélioration de l’environnement naturel ». Les ressources vivantes ont deux propriétés importantes qui les distinguent des ressources non vivantes : elles sont renouvelables si elles sont conservées, et elles sont destructibles si elles ne le sont pas.
Le développement tout comme la conservation, sont au service des êtres humains. Ainsi le développement soutenable se caractérise comme l’effet d’un double mécanisme indissociable. D’une part, le développement doit permettre d’atteindre les objectifs de bien-être social, principalement à la suite d’activités de production et de consommation de biens et de services, qui utilisent inéluctablement et largement les ressources de la biosphère. D’autre part, en retour, la conservation vise à atteindre ces objectifs en veillant à ce que cette utilisation des ressources puisse perdurer, soit soutenable, en équilibre avec le « bienêtre des écosystèmes naturels » en référence à leur capacité à se renouveler, et à conserver leur diversité ainsi que leur qualité. C’est cette définition apolitique qui doit guider le changement de paradigme.
RÉSILIENCE DES TERRITOIRES ET SOUTENABILITÉ ÉCOLOGIQUE : RETOURS D’EXPÉRIENCE
Comment concrètement engager cette transformation à l’échelle des territoires ?
Regroupant l’ensemble des parties prenantes professionnelles publiques et privées de la ville durable et résiliente, l’association France Villes et Territoires Durables (FVD) porte cette ambition au coeur de sa raison d’être. Pour accélérer la transformation durable et la résilience des territoires, FVD a défini quatre leviers d’actions5 : la sobriété pour un territoire responsable, la résilience pour un territoire adapté et réactif, l’inclusion pour un territoire « pour et avec toutes et tous » et, enfin, la créativité pour davantage de coopérations et de complémentarités territoriales.
Se référant à un développement qui n’est à ce jour ni durable et ni soutenable, FVD, en concertation avec des institutions françaises et internationales, des experts et des collectivités, a fait le choix des limites planétaires6 comme boussole territoriale. Ces limites, définies par le Stockholm Resilience Center7, représentent neuf processus naturels interdépendants qui conditionnent l’habitabilité de la Terre (dont six ne sont d’ores et déjà plus conservés) et la prospérité des sociétés humaines.
La proposition de FVD se résume en cinq étapes clés : diagnostiquer, prioriser, imaginer un récit collectif, évaluer les impacts et rendre compte. L’une des principales difficultés rencontrées réside dans le fait de fédérer les acteurs du territoire en coconstruisant le diagnostic, les priorités et le récit commun pour une action collective transformatrice soutenable d’un point de vue écologique.
La résilience des territoires est également une thématique au coeur de la recherche et des formations proposées par l’ESTP. La plateforme technologique Architecture du risque et management des décisions de l’Institut recherche de la construction de l’ESTP, mène des travaux de recherche, de développement expérimental et d’innovation métier depuis près de vingt ans sur le sujet. Au centre de ces travaux, deux concepts clés caractérisent l’environnement interne et externe des organisations sociales pour leur apporter des solutions exploitables : la complexité et l’incertitude. Ainsi, l’approche des systèmes est multi-échelle (systèmes techniques, sociotechniques, socio-économiques et socio-écologiques) et celle de la décision par les diverses parties prenantes est multicritère et intertemporelle pour tenir compte des combinaisons possibles entre les disponibilités et les décisions pouvant les impliquer.
Depuis le début de l’ère industrielle, et notamment après la seconde guerre mondiale, très peu de systèmes techniques, de « machines » au sens de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain (« Le Monde sans fin »8) disposent de la propriété de soutenabilité écologique. C’est la thèse développée dans deux publications lors du Congrès « Lambda Mu 23 » dont le thème était « Innovation et maîtrise des risques pour un avenir durable »9.
Parmi les exemples inspirants qui font exception : le système d’approvisionnement en eau et d’assainissement de la ville de Paris, conçu par Eugène Belgrand au milieu du XIXe siècle, qui fournit toujours, malgré l’augmentation de la population, la même fiabilité opérationnelle en termes de services (dependability) et continue d’utiliser la gravité pour fonctionner. À l’image de ce système, l’ESTP oeuvre pour intégrer la soutenabilité écologique aux propriétés des systèmes techniques. C’est l’ambition qui a guidé la création de la Chaire Sustainable Dependability cette année. Parmi les leviers actionnés : la formation des ingénieurs- managers de demain, dans la perspective des objectifs des Accords de Paris à horizon 2030 et de zéro émission nette en 2050, ainsi que le renforcement du leadership de leurs entreprises par l’adoption des meilleures pratiques sectorielles, créatrices de valeurs soutenables.
FAIRE ÉMERGER LES FUTURS COMPORTEMENTS À LA BONNE ÉCHELLE LOCALE
Pour définir un horizon mobilisateur, notre équipe de recherche à l’ESTP a travaillé au développement d’une méthodologie sous la forme d’un canevas systémique, capable d’inclure des aspects démographiques, sociaux, sociétaux, économiques, technologiques, énergétiques, réglementaires et financiers. Des connaissances sur de multiples parties prenantes peuvent être extraites de ce canevas, permettant d’obtenir notamment une représentation collective des enjeux, des risques, des opportunités, des valeurs partagées ainsi que des chemins critiques pour réaliser les objectifs.
Les projets qui associent une occupation humaine de l’espace au sein de régions naturelles avec des caractéristiques physiques homogènes (géomorphologie, géologie, climat, sols, ressources en eau) nous semblent la bonne échelle d’intervention.
La résilience des territoires et la sûreté de fonctionnement soutenable sont des impératifs cruciaux pour faire face aux défis environnementaux actuels. Ces concepts ne se décrètent pas mais impliquent des choix forts. Convaincus de l’importance de former des ingénieurs engagés et compétents sur le sujet, les équipes de l’ESTP se mobilisent pour intégrer la « soutenabilité » au coeur des programmes d’enseignement. Intégrée à une approche systémique, cette vision participera à réinventer un avenir commun dans des territoires vivables durablement.
1. Sustainable Buildings for the Future et Sustainable Dependability
2. Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresterie.
3. Brundtland, G. H. (1987). Notre avenir à tous. Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations
Unies. Oxford University Press.
4. IUCN (1980). World Conservation Strategy. Living Resource Conservation for Sustainable Development. Prepared by IUCN with the advice and financial
assistance od UNEP and WWF and in collaboration of the FAO and UNESCO. IUCN-UNEP-WWF.
5. France Villes & territoires Durables – Le Manifeste – Url : https://francevilledurable.fr/lassociation/manifeste/
6. FVD (2023b, 22 octobre). Les limites planétaires : nouvelle boussole pour la planification territoriale. https://francevilledurable.fr/wp-content/uploads/2023/09/
Fiche-Limites-Planetaires-web.pdf. France Villes & Territoires Durables.
7. Planetary boundaries, Stockholm Resilience Centre – url : https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
8. Jancovici, J-M, Blain, C. (2021). Le Monde sans fin. Dargaud.
9. Claude, F., Signoret, J-P. (2022). La sûreté de fonctionnement soutenable : motivations. État de l’art, verrous et hypothèses scientifiques (1). Innovations et
maîtrise des risques pour un avenir durable. Actes du Congrès Lambda Mu 23 de l’Institut de Maîtrise des Risques.
Une question ? Un projet ?
FRANCIS CLAUDE, enseignant-chercheur, responsable des Chaires Sustainable Buildings for the Future et Sustainable Dependability à l’ESTP
fclaude@estp.fr